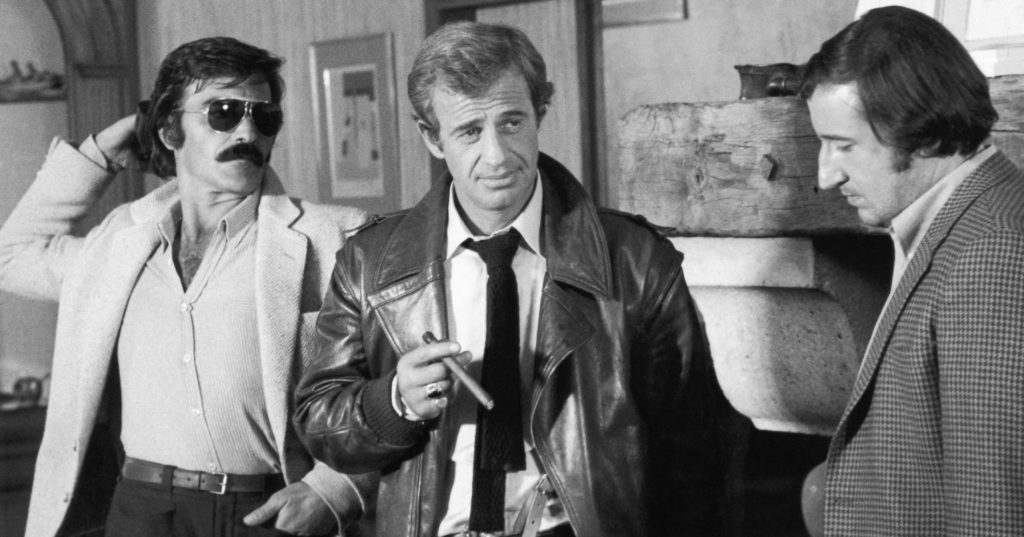
Dans l’univers complexe des clubs de motards, l’apparence peut parfois être trompeuse. C’est précisément le cas lorsqu’on observe les emblèmes des Gunfighters MC et No Surrender MC, deux organisations, dont les logos présentent d’étonnantes similitudes visuelles. Ces ressemblances superficielles masquent pourtant des philosophies diamétralement opposées, qui font de ces deux clubs un cas d’étude, dans le monde des bikers.
D’un côté, les Gunfighters MC, fondés en 2005 par d’anciens agents des forces de l’ordre, représentent un modèle rare, dans l’univers des clubs de motards : une fraternité dédiée au service de la communauté et aux valeurs positives. De l’autre, No Surrender MC, créé en 2013 et issu de tensions internes à d’autres clubs, incarne le modèle du 1% du club de bikers, cultivant une image de marginalité et d’antagonisme, envers la société établie.
Cette étude approfondie propose d’explorer les contrastes saisissants entre ces deux clubs aux emblèmes si proches, mais aux valeurs si éloignées. À travers l’analyse de leurs origines, de leurs codes visuels, de leurs structures organisationnelles et de leurs activités, nous découvrirons comment deux entités, partageant une « passion commune » pour la moto peuvent développer des visions radicalement différentes, de la fraternité motocycliste.
Sommaire
Origines et fondation : des histoires diamétralement opposées
L’analyse des racines historiques des Gunfighters MC et des No Surrender MC révèle deux trajectoires fondamentalement différentes, qui expliquent en grande partie leurs divergences philosophiques actuelles. Ces parcours distincts s’inscrivent dans des contextes historiques et sociologiques spécifiques, qui méritent d’être examinés en détail.
Gunfighters MC : quand les forces de l’ordre s’unissent (2005)
Le Gunfighters Motorcycle Club trouve son origine dans un contexte historique particulièrement significatif : les suites des attentats du 11 septembre 2001. C’est précisément, le 10 décembre 2005 qu’un groupe d’agents des forces de l’ordre, actifs et retraités, décide de fonder ce club aux États-Unis. Cette création répond à un besoin profond de fraternité et de solidarité, entre ces hommes marqués par les événements tragiques du début du millénaire.
Contrairement à la majorité des clubs de motards qui se positionnent souvent en opposition aux autorités, les Gunfighters MC présentent la particularité remarquable d’être composés exclusivement de représentants de la loi. Comme l’indique leur documentation officielle : « Nous sommes un club international composé à 100% de représentant de la loi ». Cette composition homogène explique en grande partie leur philosophie et leur approche de la culture motocycliste.
L’esprit fondateur du club s’inspire directement de l’histoire américaine, faisant référence aux premiers agents de la loi qui ont « apprivoisé les rues sauvages » dans l’Ouest américain. Le terme « gunfighter » lui-même évoque ces hommes qui utilisaient « des armes à feu, comme outils de leur commerce » pour faire respecter la loi. Cette référence historique n’est pas anodine : elle inscrit le club dans une tradition de service public et de protection de la communauté.
Le développement du club a été rapide et significatif, avec une expansion internationale remarquable. Aujourd’hui, les Gunfighters MC sont présents sur plusieurs continents, avec des chapitres en Angleterre, en Australie, en Belgique, au Brésil, au Nigeria, au Canada, au Mali, en Espagne, en Écosse, en Somalie, à Madagascar, en Italie, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, au Japon et en France. Cette présence mondiale témoigne de la résonance de leurs valeurs, au-delà des frontières américaines.
En France, notamment, leur implantation est particulièrement dense avec vingt-quatre chapitres répartis sur l’ensemble du territoire. Cette expansion témoigne d’un attrait certain pour ce modèle alternatif de club de motards, fondé sur des valeurs de service et de fraternité plutôt, que sur la marginalité.
No Surrender MC : né d’une scission et de tensions (2013)
En contraste saisissant, l’histoire du No Surrender MC s’inscrit dans une dynamique bien différente, marquée par les tensions et les rivalités internes, au monde des clubs de motards traditionnels. Fondé bien plus récemment, en 2013, ce club est né sous l’impulsion de Klaas Otto, un ancien membre du Satudarah MC, lui-même étant une branche des Hell’s Angels.
La genèse du No Surrender MC est intrinsèquement liée à des conflits, au sein de clubs préexistants. Son fondateur, Otto Klaas, a décidé de créer sa propre organisation suite à des « divergences internes » avec son précédent club. Il a été rejoint dans cette entreprise par Willem Van Boxtel, ancien membre des Hell’s Angels, qui est devenu vice-président du nouveau club. Cette origine conflictuelle marque profondément l’identité du No Surrender MC, qui se définit lui-même, selon son fondateur, comme « de la mauvaise herbe, dont personne ne voudrait« .
Le développement du club a été particulièrement rapide. En l’espace de quelques années seulement, le No Surrender MC a connu une expansion significative, revendiquant plus de 600 membres dès 2014, pour atteindre plus de 1600 membres en 2022. Cette croissance fulgurante témoigne d’une capacité remarquable à attirer de nouveaux adhérents, malgré et ou peut-être grâce, à son positionnement à la marge, de la société.
Géographiquement, le No Surrender MC s’est principalement implanté aux Pays-Bas, son pays d’origine, avant de s’étendre à d’autres territoires européens, notamment en France et en Belgique. Le club a également établi une présence au Canada, avec des membres en Alberta et au Québec, ainsi qu’un chapitre national à Peterborough, en Ontario.
Il est notable que dès 2016, soit trois ans seulement après la fondation du club, Otto Klaas a annoncé son départ de l’organisation, qu’il avait créée. Cette succession rapide à la tête du club témoigne d’une certaine instabilité structurelle, conforme à son histoire mouvementée.
Un événement particulièrement significatif dans l’histoire du No Surrender MC est survenu le 22 avril 2022, lorsque la Cour suprême des Pays-Bas a confirmé l’interdiction définitive du club, sur le territoire néerlandais, réaffirmant des décisions prises en 2019 et 2020. Cette prohibition légale marque un tournant dans l’histoire du club et illustre la nature problématique, de ses activités aux yeux des autorités.
Ces deux histoires fondatrices diamétralement opposées, l’une née : d’un désir de service et de fraternité dans le sillage d’une tragédie nationale, l’autre issue de tensions et de scissions au sein du monde des clubs hors-la-loi – constituent les socles sur lesquels se sont construites deux visions radicalement différentes de ce que peut être un club de motards dans la société contemporaine.

Valeurs et codes d’honneur : le jour et la nuit
L’étude comparative des valeurs fondamentales et des codes d’honneur des Gunfighters MC et des No Surrender MC révèle peut-être la divergence la plus profonde entre ces deux organisations. Au-delà des apparences et des structures, c’est dans leurs principes directeurs que se manifeste le plus clairement leur opposition philosophique.
Gunfighters MC : le credo du protecteur « Je suis un homme qui risque sa vie pour des inconnus »
Le système de valeurs des Gunfighters MC s’articule autour d’un credo formalisé, véritable profession de foi qui encapsule la philosophie du club. Ce texte, dont des extraits sont régulièrement cités par les membres, constitue le fondement éthique de l’organisation et mérite d’être analysé en détail :
« Je suis un homme qui risque sa vie pour des inconnus. Je suis un homme qui travaille dur pour défendre sa communauté, je me donne à fond pour défendre cet état d’esprit. Je suis un Gunfighter. Je suis un homme qui n’abandonnera jamais. Je fais de mon mieux, mais vous n’obtiendrez jamais le meilleur, car le meilleur de moi est réservé à ma famille, mes proches, mes frères. Je suis un Gunfighter. Je ne veux pas me battre, mais je le ferai, et vous perdrez. Je suis juste, mais je suis dur. Je suis un Gunfighter. »
Ce texte, attribué à un membre nommé Spaz du chapitre de Boston, révèle plusieurs valeurs cardinales du club. Tout d’abord, l’altruisme et le service (« risque sa vie pour des inconnus », « travaille dur pour défendre sa communauté ») placent l’engagement communautaire au cœur de leur identité. La persévérance (« n’abandonnera jamais ») et la loyauté envers les proches (« le meilleur de moi est réservé à ma famille, mes proches, mes frères ») définissent également leur conception de l’honneur.
Particulièrement significative est la formulation « Je ne veux pas me battre, mais je le ferai, et vous perdrez. Je suis juste, mais je suis dur. » Cette phrase condense une éthique de la force retenue, où la violence n’est pas recherchée mais peut être employée si nécessaire, toujours dans un cadre de justice (« je suis juste »). Cette approche reflète parfaitement la posture professionnelle des agents des forces de l’ordre dont sont issus les membres.
Les Gunfighters MC se définissent explicitement comme n’étant « pas un club 1% » et affirment respecter « l’ensemble des clubs, associations et bikers indépendants ». Leur positionnement est clairement énoncé : « Nous ne cherchons pas de conflits et n’interférons pas non plus avec d’autres clubs, nous accueillons la camaraderie avec les clubs disposés. Nous respectons vos droits et libertés et attendons de même pour nous. »
Cette ouverture et ce respect mutuel constituent les piliers de leur philosophie, qui privilégie la concorde et la coexistence pacifique dans l’univers des clubs de motards.
No Surrender MC : marginalité revendiquée et « pas de reddition »
En contraste frappant, les valeurs du No Surrender MC s’inscrivent dans une tradition bien différente, celle des clubs de motards qui cultivent délibérément une image de marginalité et d’opposition à la société conventionnelle.
Le nom même du club – « No Surrender » (Pas de reddition) – est déjà emblématique de cette posture inflexible. Il proclame un refus catégorique de compromis face aux normes sociales établies et aux autorités. Cette intransigeance est d’ailleurs parfaitement exprimée par Otto Klaas, le fondateur, lorsqu’il qualifie les membres de son club de « mauvaise herbe dont personne ne voudrait et qui se serait réunie ».
Cette métaphore botanique est particulièrement révélatrice : là où les plantes cultivées se plient aux désirs du jardinier, la mauvaise herbe s’impose, résiste et prolifère malgré les tentatives d’éradication. Elle symbolise parfaitement la philosophie de résistance et d’indocilité revendiquée par le club.
Contrairement aux Gunfighters MC, le No Surrender MC s’inscrit pleinement dans la tradition des clubs du « 1% », cette minorité de motards qui, selon la formule consacrée, se placent volontairement en dehors des lois et des conventions. Cette appartenance au monde des « outlaws » (hors-la-loi) n’est pas accidentelle mais constitutive de leur identité.
Les valeurs centrales du No Surrender MC comprennent une loyauté exclusive envers le club et ses membres, une méfiance systématique envers les institutions, et ce que l’on pourrait appeler une « éthique de la marge », où le respect se gagne par la force et la détermination plutôt que par le service ou la contribution à la communauté élargie.
La force commune : deux interprétations opposées de la détermination
Il existe pourtant un point de convergence paradoxal entre ces deux systèmes de valeurs antagonistes : l’importance accordée à la détermination et à la force de caractère. Mais là encore, l’interprétation de ces qualités diffère radicalement.
Pour les Gunfighters MC, la détermination s’exprime dans leur engagement à servir et protéger, conformément à leur serment professionnel d’origine : « En tant que GUNFIGHTERS et hommes de lois, nous resterons toujours fidèles aux serments que nous avons prêtés pour faire respecter la loi et servir le public. » La force est ici mise au service d’un idéal plus grand que l’individu ou même que le club : le bien commun et la protection des citoyens.
Pour No Surrender MC, la détermination prend la forme d’une résistance inflexible contre toute forme d’autorité extérieure. La devise « No Surrender » elle-même évoque un refus catégorique de céder ou de se compromettre, quelles que soient les circonstances ou les pressions. La force est davantage tournée vers l’affirmation de soi et la défense des intérêts du groupe contre un monde perçu comme hostile.
Cette différence fondamentale d’orientation – altruiste pour les Gunfighters, autocentrée pour No Surrender – se reflète dans tous les aspects de leurs organisations respectives. Et c’est peut-être dans cette opposition philosophique que réside la divergence la plus profonde entre ces deux clubs aux emblèmes si similaires mais aux âmes si différentes.
Les codes d’honneur de ces deux clubs, bien que tous deux fondés sur des notions de loyauté et de détermination, illustrent ainsi parfaitement la diversité des interprétations possibles de ces valeurs dans l’univers des clubs de motards. Ils démontrent comment des principes apparemment similaires peuvent conduire à des expressions sociales radicalement différentes selon le cadre éthique dans lequel ils s’inscrivent.
Composition et organisation : ouverture vs fermeture
La composition des membres et la structure organisationnelle des Gunfighters MC et No Surrender MC reflètent fidèlement leurs philosophies respectives. Ces deux aspects fondamentaux révèlent une opposition marquée entre un modèle inclusif mais encadré d’une part, et un système traditionnel exclusif d’autre part.
L’inclusivité encadrée des Gunfighters : membres et supporters
Le Gunfighters MC présente une structure d’adhésion distinctive qui se démarque nettement de la tradition des clubs de motards traditionnels. Leur approche peut être qualifiée d' »inclusivité encadrée » : elle ouvre les portes du club à une diversité de profils, tout en maintenant certains critères d’admission clairement définis.
La condition fondamentale pour devenir membre à part entière des Gunfighters est l’appartenance aux forces de l’ordre. Comme le précise leur documentation officielle, « pour postuler, il faut nécessairement faire partie des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie, Police Municipale, Douane) et ne pas être sous contrat. » Cette exigence professionnelle constitue la pierre angulaire de l’identité du club et garantit l’homogénéité de ses valeurs fondamentales.
Cependant, conscients que cette condition stricte pourrait exclure de nombreux passionnés partageant leurs valeurs, les Gunfighters ont créé un statut alternatif : celui de « Support Gunfighters ». Cette catégorie permet à des personnes n’appartenant pas aux forces de l’ordre de participer aux activités du club et d’en porter les couleurs. Comme ils l’expliquent : « Vous ne pourrez pas devenir membre des gunfighters et porter le LEO mais vous pouvez tout à fait postuler pour devenir Support Gunfighters, et participer aux événements à nos cotés. »
Cette double structure d’adhésion témoigne d’une volonté d’ouverture sans pour autant diluer l’identité professionnelle au cœur du club. Elle permet de créer une communauté élargie autour du noyau dur des membres officiels, renforçant ainsi son influence et sa visibilité.
Un autre aspect remarquable de la politique d’adhésion des Gunfighters est son ouverture à la diversité. Contrairement à de nombreux clubs traditionnels, « les femmes sont acceptées en tant que membres ou en tant que supportrices, les personnes racisées également. » Cette inclusivité volontaire est explicitement soulignée comme une rupture avec les pratiques discriminatoires courantes dans l’univers des clubs de motards : « Nous sommes loin d’un univers sectaire et exclusif comme peuvent l’être les autres clubs de motard, beaucoup plus hostiles à tout ce qui ne leur ressemble pas. »
Le processus d’intégration lui-même, bien que rigoureux, reste relativement accessible. Pour devenir membre, le candidat doit « contacter le chapitre le plus proche de chez vous pour vous faire connaitre » et passer par « une periode probatoire minimale d’un an », avant de « pouvoir prétendre à devenir un Gunfighter. » Cette période d’essai, bien que significative, est considérablement plus courte et moins éprouvante que celle imposée par les clubs traditionnels.
L’exigence commune : la moto américaine comme symbole d’appartenance
Malgré leurs différences fondamentales, Gunfighters MC et No Surrender MC partagent une exigence commune : la possession d’une moto de fabrication américaine ou, dans le cas des Gunfighters, « de conception américaine ».
Pour les Gunfighters, cette condition est clairement énoncée : « Pour postuler, […] il faut également être possesseur d’une moto fabriquée aux USA. » Cette règle est toutefois interprétée avec une certaine souplesse, puisqu’ils précisent : « Vous n’êtes pas obligé de posséder une Harley, la seule condition est que votre moto doit avoir été conçue aux États-Unis. » Cette nuance élargit considérablement l’éventail des machines acceptables.
Cette exigence commune reflète l’héritage américain de la culture biker, où la moto n’est pas qu’un moyen de transport mais un symbole identitaire fort. La préférence pour les motos américaines s’enracine dans l’histoire même des clubs de motards, nés après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Elle traduit également un attachement à certaines valeurs associées à ces machines : puissance, liberté, tradition et une certaine conception de l’authenticité.
Il est significatif que cette condition soit l’une des rares que partagent deux clubs aux philosophies par ailleurs si divergentes. Elle témoigne de la force symbolique persistante de ces machines dans l’univers des bikers, par-delà les clivages idéologiques.
L’exclusivité traditionnelle des No Surrender : origines et recrutement sélectif
Le No Surrender MC, fidèle à la tradition des clubs du « 1% », présente une structure beaucoup plus fermée et exclusive. Plusieurs aspects de son organisation témoignent de cette approche traditionnelle.
Tout d’abord, sa composition sociale présente une homogénéité notable. Selon les sources documentaires, « les leaders sont principalement des Dutch Travellers [nl] ou d’origine turque et kurde. » Cette concentration ethnique contraste fortement avec l’ouverture revendiquée des Gunfighters et s’inscrit dans la tradition des clubs de motards classiques, souvent structurés autour d’affinités ethniques ou culturelles précises.
Le club maintient également des barrières strictes à l’entrée, typiques des MC traditionnels : « Les femmes ne sont pas acceptées dans le groupe, les personnes racisées ne sont pas spécialement bienvenues ». Ces politiques discriminatoires délibérées contrastent fortement avec l’inclusivité des Gunfighters et reflètent une vision beaucoup plus conservatrice et exclusive du compagnonnage motard.
Le processus de recrutement, bien que moins documenté publiquement que celui des Gunfighters, semble suivre le modèle classique des clubs du 1% : période de probation exigeante, loyauté absolue envers le club, et nécessité de faire ses preuves auprès des membres existants. Ce système sélectif garantit une forte cohésion interne mais limite considérablement la diversité du groupe.
Un élément particulièrement significatif de l’organisation de No Surrender est l’exigence de loyauté exclusive envers le club. Contrairement aux Gunfighters qui permettent un statut de supporter moins engageant, No Surrender, comme la plupart des clubs traditionnels, exige une allégeance totale et exclusive. Cette exigence se traduit notamment par le port des « couleurs » (le patch dorsal), qui symbolise l’appartenance pleine et entière au club.
Cette différence dans les structures d’adhésion et les critères de recrutement entre les deux clubs reflète leurs visions opposées de la fraternité motocycliste : l’une ouverte sur la diversité sociale tout en maintenant une cohérence professionnelle, l’autre repliée sur une identité exclusive et définie par opposition au reste de la société.
La composition et l’organisation de ces deux clubs illustrent ainsi parfaitement comment des structures sociales peuvent incarner des valeurs et des visions du monde radicalement différentes, tout en partageant une passion commune pour la moto et certaines traditions esthétiques et symboliques.
Activités et rapport à la loi : l’antithèse parfaite
Les activités menées par les Gunfighters MC et les No Surrender MC, ainsi que leur relation respective avec l’appareil judiciaire, constituent peut-être le domaine où leur opposition philosophique se manifeste le plus concrètement. L’analyse de ces aspects révèle deux modèles diamétralement opposés d’engagement social et de rapport à la légalité.
Les actions caritatives et communautaires des Gunfighters
Les Gunfighters MC se distinguent par un engagement actif dans diverses activités caritatives et communautaires, conformément à leur éthique de service héritée de leur profession d’origine. Cette orientation altruiste constitue une caractéristique essentielle de leur identité collective.
Comme le décrit leur documentation, les Gunfighters sont « invités à de nombreuses manifestations » et organisent « beaucoup d’actions caritatives ». Leur présence sur les réseaux sociaux témoigne de cette implication régulière, la « page Facebook du chapitre français par exemple étant très régulièrement fournie, en plus d’être marquée par le sceau de la convivialité. »
Un exemple concret de cet engagement est leur participation à « Octobre Rose », événement annuel dédié à la sensibilisation au cancer du sein et à la collecte de fonds pour la recherche. Cette cause, qui mobilise des milliers de personnes à travers le monde, illustre parfaitement le type d’actions auxquelles les Gunfighters s’associent : des initiatives positives, inclusives et orientées vers le bien-être collectif.
L’acteur américain Robert Patrick, membre du chapitre 101 des Gunfighters, résume d’ailleurs parfaitement cette orientation en décrivant le club comme « une organisation à but non lucratif qui amasse des fonds pour aider les vétérans, les enfants et les pauvres ». Cette caractérisation, provenant d’une figure publique associée au club, souligne la vocation philanthropique qui anime le Gunfighters MC.
Cette approche communautaire s’inscrit dans la continuité directe de leur identité professionnelle d’agents des forces de l’ordre. Elle traduit une conception du club de motards comme extension de leur mission de service public, transposée dans un cadre associatif et fraternel.
Un autre aspect significatif de leurs activités est leur stratégie de communication « moderne », utilisant activement les réseaux sociaux pour promouvoir leurs événements et valeurs. Cette transparence et cette volonté de visibilité positive contrastent fortement avec la discrétion traditionnellement cultivée par les clubs de motards plus conventionnels.
Le parcours délictueux des No Surrender et leurs démêlés avec la justice
À l’opposé de cette orientation communautaire et charitable se trouve le parcours du No Surrender MC, marqué par de nombreux incidents judiciaires et une relation conflictuelle avec les autorités. Leur historique révèle un modèle typique des clubs de motards du « 1% », où les activités en marge de la légalité font partie intégrante de l’identité du groupe.
Dès sa fondation, le club s’est inscrit dans une tradition de conflictualité, notamment avec d’autres organisations de motards. Les sources documentaires évoquent « de nombreuses disputes et des bagarres, avec les autres club de motards ». Ces affrontements interclubs, loin d’être anecdotiques, ont parfois atteint des niveaux de violence significatifs, comme l’illustre l’incident de 2015 où « suite à une blessure lors d’une fusillade […], le propre président du club a annoncé son retrait vis-à-vis du gang. »
Les démêlés du No Surrender MC avec la justice ont culminé en 2019 avec son interdiction aux Pays-Bas, confirmée définitivement par la Cour suprême en 2022. Cette mesure radicale, qui fait suite à des « actions délictueuses » répétées, témoigne de la gravité des infractions attribuées au club par les autorités néerlandaises.
Le document source note qu’il est « impossible ici de procéder à un historique exhaustif de toutes les actions délictueuses menées par les No Surrender, d’autant que la très grande majorité de ses actions reste confidentielle et inconnue du grand public. » Cette remarque suggère que les incidents documentés ne représentent que la partie visible d’activités illégales plus étendues.
Parmi les domaines d’activité criminelle attribués au No Surrender figurent « le trafic de drogue, les attaques à main armée, et le grand banditisme ». Ces pratiques s’inscrivent dans une stratégie double visant, selon les sources, « à la fois une forme de légitimité vis-à-vis des autres gangs, et une autonomie financière, qui leur permet de prospérer. »
Plus récemment, le 26 juillet 2022, « une explosion s’est produite au domicile de Gracia K. à ‘s-Hertogenbosch, qui avait récemment commencé à fréquenter l’ancien leader du No Surrender, Klaas Otto. » Cet incident, bien que ses circonstances exactes ne soient pas entièrement élucidées, illustre l’environnement de violence qui continue d’entourer le club et ses figures dirigeantes, même après leur départ officiel.
Le cas paradoxal : des membres de No Surrender contre l’État Islamique
Un aspect particulièrement intrigant de l’histoire récente du No Surrender MC est l’engagement de certains de ses membres dans un contexte géopolitique inattendu. En 2014, selon les sources documentaires, « trois membres du groupe auraient voyagé en Irak pour combattre aux côtés des forces kurdes dans la guerre contre l’État islamique ». Cette initiative, qui pourrait paraître surprenante de la part d’un club généralement en opposition avec les structures d’autorité, révèle la complexité des motivations et des valeurs qui peuvent animer ses membres.
Les autorités néerlandaises ont d’ailleurs précisé que cet engagement n’était « pas en soi un crime », témoignant d’une certaine reconnaissance de la légitimité de cette action spécifique. Malheureusement, l’un de ces volontaires, surnommé « Nomad Ron », est décédé en juin 2015 dans un accident de la circulation.
Cet épisode singulier illustre un paradoxe intéressant : même au sein d’organisations généralement associées à des activités illégales peuvent émerger des initiatives alignées sur des valeurs largement partagées par la société, comme l’opposition à l’extrémisme violent. Il suggère également que les motivations individuelles des membres peuvent parfois transcender l’orientation générale du club auquel ils appartiennent.
Ce cas particulier nuance l’image uniformément négative souvent associée aux clubs du « 1% » et rappelle la complexité des réalités humaines qui se cachent derrière les étiquettes institutionnelles. Il montre que même au sein des organisations les plus controversées peuvent coexister des impulsions constructives et destructives, des comportements prosociaux et antisociaux.
L’antithèse entre les Gunfighters MC et les No Surrender MC en matière d’activités et de rapport à la loi ne pourrait être plus marquée : d’un côté, un club fondé par des agents des forces de l’ordre qui prolonge leur mission de service dans le cadre associatif ; de l’autre, une organisation régulièrement en conflit avec ces mêmes autorités et associée à diverses formes de criminalité. Cette opposition fondamentale s’inscrit dans le prolongement direct de leurs philosophies respectives et illustre comment des valeurs divergentes se traduisent concrètement dans les actions collectives.
Conclusion : deux visages du monde biker
Au terme de cette analyse comparative, les Gunfighters MC et No Surrender MC apparaissent comme deux expressions diamétralement opposées de la culture motocycliste contemporaine. Malgré leurs emblèmes visuellement proches, ces clubs incarnent des visions radicalement différentes de ce que signifie la fraternité motarde au XXIe siècle. Cette dualité pose des questions fondamentales sur la coexistence de ces modèles antagonistes et l’évolution future du monde biker.
Coexistence improbable : comment deux clubs si opposés peuvent-ils partager le même espace?
L’existence parallèle des Gunfighters MC et des No Surrender MC dans le paysage motocycliste mondial constitue un paradoxe sociologique fascinant. Comment deux organisations aux philosophies si radicalement opposées peuvent-elles prospérer simultanément dans un univers aussi codifié que celui des clubs de motards?
Cette coexistence, parfois tendue mais néanmoins effective, s’explique en partie par la segmentation territoriale et sociale du monde biker. Les Gunfighters MC, composés exclusivement d’agents des forces de l’ordre, évoluent principalement dans des sphères institutionnelles et communautaires légitimes, tandis que No Surrender MC occupe des espaces plus marginaux, à la frontière de la légalité. Cette séparation des territoires sociaux et physiques limite les occasions de confrontation directe.
La déclaration explicite des Gunfighters selon laquelle ils « ne cherchent pas de conflits et n’interfèrent pas non plus avec d’autres clubs » témoigne également d’une stratégie délibérée d’évitement des tensions. Cette posture non-confrontationnelle, inhabituelle dans l’univers traditionnellement territorial des clubs de motards, contribue à rendre possible cette coexistence improbable.
Il existe également une forme de complémentarité fonctionnelle entre ces deux modèles. Les Gunfighters MC offrent une alternative légitime et socialement acceptée pour les passionnés de moto qui souhaitent vivre une expérience de fraternité sans s’engager dans des activités marginales, tandis que No Surrender MC perpétue la tradition « outlaw » qui a historiquement défini l’identité des clubs de motards. Cette diversification des modèles permet de répondre aux aspirations variées des amateurs de deux-roues.
Néanmoins, cette coexistence reste fragile et potentiellement conflictuelle. L’histoire des clubs de motards est jalonnée d’affrontements entre organisations aux territoires ou aux intérêts concurrents. La stabilité relative observée entre ces deux modèles opposés pourrait être remise en question par des changements dans les dynamiques de pouvoir, des expansions territoriales ou des évolutions législatives.
L’avenir du monde biker : vers plus d’ouverture ou persistance du modèle traditionnel?
La coexistence des Gunfighters MC et des No Surrender MC soulève une question fondamentale sur l’évolution future de la culture biker : assiste-t-on à une transformation progressive vers des modèles plus ouverts et intégrés socialement, ou le modèle traditionnel des clubs du « 1% » conservera-t-il sa place prépondérante?
Plusieurs indicateurs suggèrent une tendance vers une plus grande diversification et une ouverture accrue. L’expansion remarquable des Gunfighters MC, avec leur modèle inclusif et leur engagement communautaire, témoigne d’une demande croissante pour des formes d’appartenance motocycliste compatibles avec les valeurs sociales contemporaines. Comme le note leur documentation, leurs « valeurs pacifiques […] séduisent davantage les motards que l’embrigadement somme toute assez malsain qu’imposent les autres gangs à leurs membres. »
Les difficultés légales rencontrées par No Surrender MC, culminant avec son interdiction aux Pays-Bas, illustrent également les pressions croissantes exercées sur le modèle traditionnel des clubs du « 1% ». Les sociétés contemporaines, avec leurs capacités de surveillance et de régulation accrues, offrent un environnement de moins en moins favorable aux organisations opérant à la marge de la légalité.
Cependant, d’autres facteurs suggèrent la persistance durable du modèle traditionnel. La croissance rapide de No Surrender MC, passant de sa création en 2013 à plus de 1600 membres en 2022, démontre l’attrait persistant du modèle « outlaw ». Ce modèle répond à des besoins psychosociaux profonds de certains individus : sentiment d’appartenance exclusive, affirmation d’une identité marginale, et rejet des contraintes sociales conventionnelles.
L’histoire cyclique des clubs de motards suggère également une capacité d’adaptation remarquable du modèle traditionnel face aux pressions légales et sociales. L’interdiction d’un club conduit souvent à sa réorganisation sous une nouvelle bannière plutôt qu’à sa disparition véritable, comme l’illustre l’histoire même du No Surrender MC, né des tensions au sein d’autres clubs préexistants.
L’avenir verra probablement non pas la victoire définitive d’un modèle sur l’autre, mais plutôt une diversification continue du paysage motocycliste, avec la coexistence de multiples formes d’organisations répondant à des aspirations variées : des clubs traditionnels maintenant l’ethos « outlaw » originel, des organisations plus ouvertes comme les Gunfighters MC, et potentiellement de nouvelles formes hybrides combinant des éléments des deux traditions.
Le paradoxe des emblèmes : quand la similitude visuelle cache une opposition fondamentale
Le cas des Gunfighters MC et des No Surrender MC illustre de façon saisissante comment des symboles visuellement proches peuvent véhiculer des messages radicalement différents selon leur contexte et leur interprétation.
Les deux clubs utilisent une iconographie similaire – crânes, armes à feu, chapeau – mais ces éléments communs sont réinterprétés à travers des prismes idéologiques opposés. Le crâne souriant des Gunfighters devient un symbole d’ouverture et de vigilance bienveillante, tandis que le crâne hurlant de No Surrender évoque la menace et l’agressivité. Les revolvers, symboles de protection légale pour les uns, deviennent des instruments d’intimidation pour les autres.
Cette divergence d’interprétation de symboles similaires rappelle que les signes visuels n’ont pas de signification intrinsèque immuable, mais tirent leur sens du contexte social et des valeurs qu’ils sont censés représenter. Les emblèmes de ces deux clubs fonctionnent comme des palimpsestes culturels, où des éléments iconographiques communs sont réinvestis de significations nouvelles en fonction de l’ethos propre à chaque organisation.
Ce phénomène de réappropriation symbolique n’est pas unique au monde des clubs de motards mais reflète un processus culturel plus large, où des communautés différentes peuvent utiliser un vocabulaire visuel similaire tout en exprimant des valeurs et des identités profondément divergentes.
La similitude visuelle entre les emblèmes de ces deux clubs aux philosophies opposées pourrait également être interprétée comme le signe d’une tension fondamentale inhérente à la culture biker elle-même : entre ordre et rébellion, entre intégration et marginalité, entre protection et intimidation. Ces polarités, présentes depuis les origines du phénomène des clubs de motards, continuent de structurer ce monde social complexe et fascinent.
En définitive, les Gunfighters MC et No Surrender MC, par leur coexistence paradoxale et leurs visions antagonistes, nous offrent une fenêtre privilégiée sur les dynamiques contemporaines de la culture motocycliste. Ils illustrent la capacité remarquable de cette culture à se réinventer tout en préservant certains de ses codes fondamentaux, démontrant ainsi sa vitalité et sa pertinence continue dans un monde en constante évolution.
Activités et rapport à la loi : l’antithèse parfaite
Les activités menées par les Gunfighters MC et les No Surrender MC, ainsi que leur relation respective avec l’appareil judiciaire, constituent peut-être le domaine où leur opposition philosophique se manifeste le plus concrètement. L’analyse de ces aspects révèle deux modèles diamétralement opposés d’engagement social et de rapport à la légalité.
Les actions caritatives et communautaires des Gunfighters
Les Gunfighters MC se distinguent par un engagement actif dans diverses activités caritatives et communautaires, conformément à leur éthique de service héritée de leur profession d’origine. Cette orientation altruiste constitue une caractéristique essentielle de leur identité collective.
Comme le décrit leur documentation, les Gunfighters sont « invités à de nombreuses manifestations » et organisent « beaucoup d’actions caritatives ». Leur présence sur les réseaux sociaux témoigne de cette implication régulière, la « page Facebook du chapitre français par exemple étant très régulièrement fournie, en plus d’être marquée par le sceau de la convivialité. »
Un exemple concret de cet engagement est leur participation à « Octobre Rose », événement annuel dédié à la sensibilisation au cancer du sein et à la collecte de fonds pour la recherche. Cette cause, qui mobilise des milliers de personnes à travers le monde, illustre parfaitement le type d’actions auxquelles les Gunfighters s’associent : des initiatives positives, inclusives et orientées vers le bien-être collectif.
L’acteur américain Robert Patrick, membre du chapitre 101 des Gunfighters, résume d’ailleurs parfaitement cette orientation en décrivant le club comme « une organisation à but non lucratif qui amasse des fonds pour aider les vétérans, les enfants et les pauvres ». Cette caractérisation, provenant d’une figure publique associée au club, souligne la vocation philanthropique qui anime le Gunfighters MC.
Cette approche communautaire s’inscrit dans la continuité directe de leur identité professionnelle d’agents des forces de l’ordre. Elle traduit une conception du club de motards comme extension de leur mission de service public, transposée dans un cadre associatif et fraternel.
Un autre aspect significatif de leurs activités est leur stratégie de communication « moderne », utilisant activement les réseaux sociaux pour promouvoir leurs événements et valeurs. Cette transparence et cette volonté de visibilité positive contrastent fortement avec la discrétion traditionnellement cultivée par les clubs de motards plus conventionnels.
Le parcours délictueux des No Surrender et leurs démêlés avec la justice
À l’opposé de cette orientation communautaire et charitable se trouve le parcours du No Surrender MC, marqué par de nombreux incidents judiciaires et une relation conflictuelle avec les autorités. Leur historique révèle un modèle typique des clubs de motards du « 1% », où les activités en marge de la légalité font partie intégrante de l’identité du groupe.
Dès sa fondation, le club s’est inscrit dans une tradition de conflictualité, notamment avec d’autres organisations de motards. Les sources documentaires évoquent « de nombreuses disputes et des bagarres, avec les autres club de motards ». Ces affrontements interclubs, loin d’être anecdotiques, ont parfois atteint des niveaux de violence significatifs, comme l’illustre l’incident de 2015 où « suite à une blessure lors d’une fusillade […], le propre président du club a annoncé son retrait vis-à-vis du gang. »
Les démêlés du No Surrender MC avec la justice ont culminé en 2019 avec son interdiction aux Pays-Bas, confirmée définitivement par la Cour suprême en 2022. Cette mesure radicale, qui fait suite à des « actions délictueuses » répétées, témoigne de la gravité des infractions attribuées au club par les autorités néerlandaises.
Le document source note qu’il est « impossible ici de procéder à un historique exhaustif de toutes les actions délictueuses menées par les No Surrender, d’autant que la très grande majorité de ses actions reste confidentielle et inconnue du grand public. » Cette remarque suggère que les incidents documentés ne représentent que la partie visible d’activités illégales plus étendues.
Parmi les domaines d’activité criminelle attribués au No Surrender figurent « le trafic de drogue, les attaques à main armée, et le grand banditisme ». Ces pratiques s’inscrivent dans une stratégie double visant, selon les sources, « à la fois une forme de légitimité vis-à-vis des autres gangs, et une autonomie financière, qui leur permet de prospérer. »
Plus récemment, le 26 juillet 2022, « une explosion s’est produite au domicile de Gracia K. à Hertogenbosch, qui avait récemment commencé à fréquenter l’ancien leader du No Surrender, Klaas Otto. » Cet incident, bien que ses circonstances exactes ne soient pas entièrement élucidées, illustre l’environnement de violence qui continue d’entourer le club et ses figures dirigeantes, même après leur départ officiel.
Le cas paradoxal : des membres de No Surrender contre l’État Islamique
Un aspect particulièrement intrigant de l’histoire récente du No Surrender MC est l’engagement de certains de ses membres dans un contexte géopolitique inattendu. En 2014, selon les sources documentaires, « trois membres du groupe auraient voyagé en Irak pour combattre aux côtés des forces kurdes dans la guerre contre l’État islamique ». Cette initiative, qui pourrait paraître surprenante de la part d’un club généralement en opposition avec les structures d’autorité, révèle la complexité des motivations et des valeurs qui peuvent animer ses membres.
Les autorités néerlandaises ont d’ailleurs précisé que cet engagement n’était « pas en soi un crime », témoignant d’une certaine reconnaissance de la légitimité de cette action spécifique. Malheureusement, l’un de ces volontaires, surnommé « Nomad Ron », est décédé en juin 2015 dans un accident de la circulation.
Cet épisode singulier illustre un paradoxe intéressant : même au sein d’organisations généralement associées à des activités illégales peuvent émerger des initiatives alignées sur des valeurs largement partagées par la société, comme l’opposition à l’extrémisme violent. Il suggère également que les motivations individuelles des membres peuvent parfois transcender l’orientation générale du club auquel ils appartiennent.
Ce cas particulier nuance l’image uniformément négative souvent associée aux clubs du « 1% » et rappelle la complexité des réalités humaines qui se cachent derrière les étiquettes institutionnelles. Il montre que même au sein des organisations les plus controversées peuvent coexister des impulsions constructives et destructives, des comportements prosociaux et antisociaux.
L’antithèse entre les Gunfighters MC et les No Surrender MC en matière d’activités et de rapport à la loi ne pourrait être plus marquée : d’un côté, un club fondé par des agents des forces de l’ordre qui prolonge leur mission de service dans le cadre associatif ; de l’autre, une organisation régulièrement en conflit avec ces mêmes autorités et associée à diverses formes de criminalité. Cette opposition fondamentale s’inscrit dans le prolongement direct de leurs philosophies respectives et illustre comment des valeurs divergentes se traduisent concrètement dans les actions collectives.
Implantation internationale : expansion parallèle
Les trajectoires géographiques des Gunfighters MC et des No Surrender MC, bien que fondamentalement différentes dans leurs modalités et leurs motivations, partagent une caractéristique commune : une expansion internationale rapide et significative. L’analyse de cette dimension territoriale révèle à la fois des stratégies de développement distinctes et des enjeux socio-culturels propres à chaque organisation.
La présence mondiale des Gunfighters : une ouverture extraordinaire
L’expansion internationale des Gunfighters MC présente des caractéristiques remarquables, tant par son ampleur que par sa diversité géographique. Depuis sa fondation aux États-Unis en 2005, le club a connu un développement global véritablement exceptionnel dans l’univers des clubs de motards.
Selon leur documentation officielle, les Gunfighters MC possèdent aujourd’hui « des chapitres en Angleterre, en Australie, en Belgique, au Brésil, au Nigeria, au Canada, au Mali, en Espagne, en Écosse, en Somalie, à Madagascar, en Italie, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, au Japon et en France. » Cette présence sur six continents témoigne d’une capacité d’adaptation culturelle peu commune et d’un attrait transculturel pour leur modèle organisationnel.
Particulièrement notable est l’implantation du club dans plusieurs pays africains comme le Nigeria, le Mali, Madagascar et la Somalie. Comme le souligne leur documentation, « des pays africains par exemple n’étant pas très représentatifs des clubs de motard, qui sont très souvent fermés aux populations racisées. » Cette percée sur le continent africain distingue nettement les Gunfighters des clubs traditionnels et témoigne de leur ouverture à la diversité culturelle et ethnique.
En France, l’implantation des Gunfighters est particulièrement dense avec « pas moins de vingt-quatre chapitres répartis de manière assez harmonieuse dans le Nord et le Sud du pays. » Cette forte présence hexagonale est d’autant plus significative que la France est présentée comme « pionnière du tout premier chapitre européen » des Gunfighters, soulignant le rôle central du pays dans le développement international du club.
L’expansion des Gunfighters semble suivre une logique de réseau professionnel international, s’appuyant sur les connections entre agents des forces de l’ordre de différents pays. Cette dynamique explique en partie leur capacité à s’implanter dans des régions généralement peu réceptives à la culture des clubs de motards traditionnels. Comme le remarque leur documentation, « tout porte à croire que les valeurs pacifiques promues par les Gunfighters séduisent davantage les motards que l’embrigadement somme toute assez malsain qu’imposent les autres gangs à leurs membres. »
Cette approche expansive repose également sur une structure organisationnelle flexible, capable de s’adapter aux contextes légaux et culturels variés des différents pays d’implantation, tout en maintenant une cohérence identitaire forte autour des valeurs fondamentales du club.
L’expansion européenne des No Surrender et son interdiction aux Pays-Bas
Le développement territorial du No Surrender MC, bien que significatif, suit une trajectoire très différente, plus concentrée géographiquement et plus conflictuelle dans ses relations avec les autorités locales.
Fondé aux Pays-Bas en 2013, le club a connu une expansion rapide principalement en Europe. Selon les sources documentaires, « le club possède de nombreux chapitres en France, en Belgique et aux Pays-Bas. » Cette concentration européenne contraste avec la présence véritablement mondiale des Gunfighters et suggère une stratégie d’expansion plus régionale.
Le No Surrender MC a également établi une présence au Canada, « avec des membres en Alberta/Québec, et un chapitre national à Peterborough, Ontario. » Cette implantation nord-américaine représente une extension significative au-delà de son bastion européen d’origine.
Un aspect particulièrement remarquable de l’expansion du No Surrender est la résistance institutionnelle qu’il a rencontrée, culminant avec son interdiction définitive aux Pays-Bas. Comme le précisent les sources, « le 22 avril 2022, la Cour suprême des Pays-Bas a réaffirmé les interdictions précédentes de 2019 et 2020 sur No Surrender aux Pays-Bas, rendant cette interdiction permanente. » Cette prohibition légale dans son pays d’origine représente un obstacle majeur à son développement et illustre la perception négative du club par les autorités.
Cette interdiction s’inscrit dans une politique plus large de lutte contre les clubs de motards considérés comme problématiques aux Pays-Bas. Elle fait suite à une série d’incidents et d’activités illégales attribuées au club, qui ont conduit les autorités néerlandaises à prendre des mesures radicales pour limiter son influence.
La stratégie d’expansion du No Surrender semble suivre le modèle classique des clubs du « 1% », avec une logique territoriale affirmée. Contrairement aux Gunfighters qui privilégient une approche inclusive et ouverte, le No Surrender adopte une posture plus assertive, potentiellement source de tensions avec les clubs préexistants dans les territoires où il s’implante.
Accueil et perception locale : respect vs méfiance
La réception des deux clubs dans leurs zones d’implantation respectives reflète fidèlement leurs philosophies et leurs activités divergentes.
Les Gunfighters MC bénéficient généralement d’un accueil favorable, facilité par la profession de leurs membres et leur engagement communautaire. Comme le note leur documentation, ils sont « invités à de nombreuses manifestations » et leur page Facebook est « marquée par le sceau de la convivialité. » Cette perception positive repose sur plusieurs facteurs : leur statut d’agents des forces de l’ordre qui inspire confiance, leurs activités caritatives qui démontrent leur engagement social positif, et leur politique d’ouverture qui favorise l’intégration locale.
En contraste direct, le No Surrender MC suscite souvent méfiance et vigilance de la part des autorités et des communautés locales. Son interdiction aux Pays-Bas représente l’expression ultime de cette perception négative, justifiée par les autorités par son association à diverses activités criminelles. Comme le résume la documentation, le club « se distingue en particulier dans le trafic de drogue, les attaques à main armée, et le grand banditisme. » Ces activités engendrent naturellement une réaction défensive des institutions locales et une perception négative au sein des communautés environnantes.
Cette différence d’accueil et de perception n’est pas simplement le résultat d’un préjugé ou d’une discrimination arbitraire, mais la conséquence directe des activités et des valeurs promues par chaque club. Elle illustre comment des organisations superficiellement similaires dans leur forme (clubs de motards) peuvent générer des réactions sociales radicalement différentes en fonction de leur comportement effectif et de leur relation avec la société environnante.
L’analyse de l’implantation internationale des deux clubs révèle ainsi des dynamiques d’expansion fondamentalement différentes, reflets de leurs philosophies respectives : l’une privilégiant l’ouverture, la diversité et l’intégration harmonieuse, l’autre adoptant une approche plus territoriale, potentiellement conflictuelle et souvent en tension avec les autorités locales. Ces trajectoires géographiques distinctes, malgré leur succès parallèle en termes d’expansion, illustrent deux conceptions radicalement différentes de ce que signifie être un club de motards international dans le monde contemporain.
Conclusion : deux visages du monde biker
Au terme de cette analyse comparative, les Gunfighters MC et No Surrender MC apparaissent comme deux expressions diamétralement opposées de la culture motocycliste contemporaine. Malgré leurs emblèmes visuellement proches, ces clubs incarnent des visions radicalement différentes de ce que signifie la fraternité motarde au XXIe siècle. Cette dualité pose des questions fondamentales sur la coexistence de ces modèles antagonistes et l’évolution future du monde biker.
